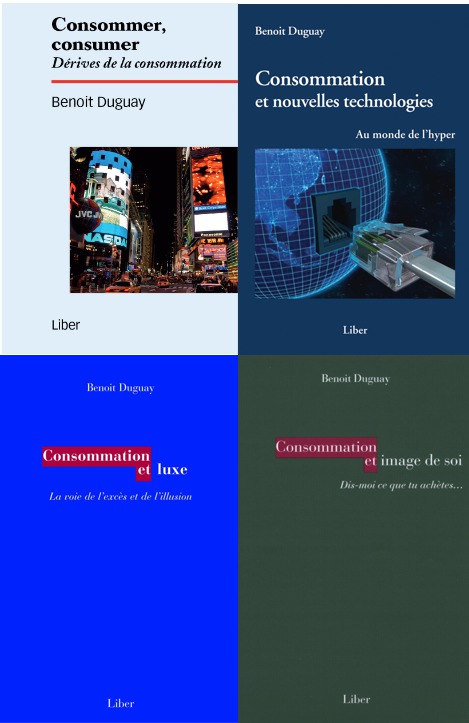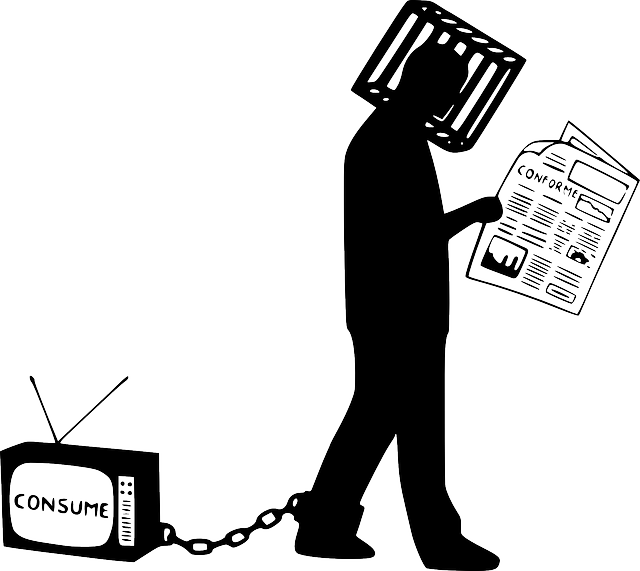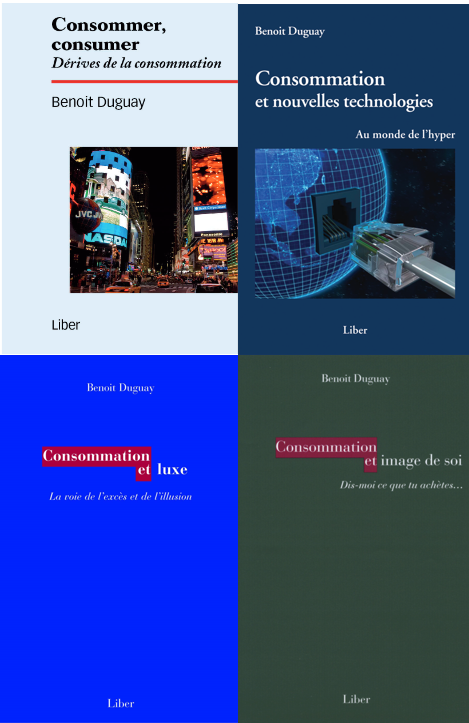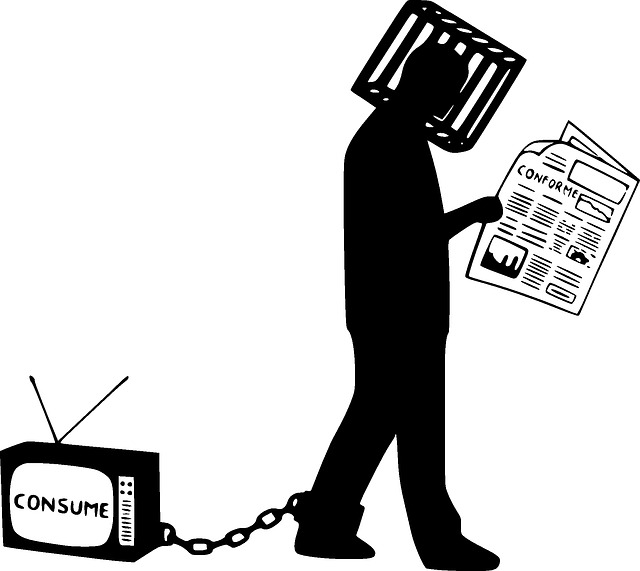
Crédit: Pixabay
Robert Rochefort avait raison de dire que « la société de consommation est la moins mauvaise des formes de société testées jusqu’à présent (1)» ; elle a à tout le moins apporté un certain confort matériel à une grande partie de la population des pays industrialisés. Cela dit, le rythme de consommation s’est emballé de sorte que, dans notre monde postmoderne, l’hyperconsommation s’est partout installée à demeure, de l’Afghanistan au Zimbabwe — la seule différence entre les pays riches et les pays pauvres étant que la classe moyenne participe aux plaisirs de la consommation dans les premiers alors que seule l’élite y a droit dans les seconds.
De façon analogue, le capitalisme s’est lui aussi révélé être la moins mauvaise des formes d’organisation économique, sociologique et politique, mais il n’en doit pas moins corriger les dérives auxquelles il a donné naissance, entre autres les inégalités abyssales que les pratiques actuelles ont engendrées ; je ne parle pas d’une répartition parfaitement égalitaire de la richesse, une utopie à mon avis, mais l’élimination des écarts scandaleux. Il n’est ni normal ni acceptable, en particulier au sein de sociétés riches et démocratiques, que des gens ne mangent pas à leur faim, alors que d’autres se vautrent dans le luxe.
En même temps, si certains n’ont même l’essentiel, d’autres, sous l’emprise de leurs modes de vie, se sont endettés au point d’être en voie de se consumer. Quelles leçons doit-on tirer de ces constats? Quelles sont les conséquences des dérives relevées? Quelles sont les causes véritables de ces dérives? Quelles initiatives l’acheteur et les acteurs de l’offre doivent-ils prendre pour éviter le pire? Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette tribune et les suivantes. Commençons avec la rémunération des acteurs de l’offre.
De façon analogue, le capitalisme s’est lui aussi révélé être la moins mauvaise des formes d’organisation économique, sociologique et politique, mais il n’en doit pas moins corriger les dérives auxquelles il a donné naissance, entre autres les inégalités abyssales que les pratiques actuelles ont engendrées ; je ne parle pas d’une répartition parfaitement égalitaire de la richesse, une utopie à mon avis, mais l’élimination des écarts scandaleux. Il n’est ni normal ni acceptable, en particulier au sein de sociétés riches et démocratiques, que des gens ne mangent pas à leur faim, alors que d’autres se vautrent dans le luxe.
En même temps, si certains n’ont même l’essentiel, d’autres, sous l’emprise de leurs modes de vie, se sont endettés au point d’être en voie de se consumer. Quelles leçons doit-on tirer de ces constats? Quelles sont les conséquences des dérives relevées? Quelles sont les causes véritables de ces dérives? Quelles initiatives l’acheteur et les acteurs de l’offre doivent-ils prendre pour éviter le pire? Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette tribune et les suivantes. Commençons avec la rémunération des acteurs de l’offre.
Les écarts salariaux entre travailleurs et hauts dirigeants sont abyssaux. Cette fracture financière doit être réduite, car elle est maintenant devenue carrément immorale; personne ne mérite une rémunération chiffrée à plusieurs millions de dollars, alors qu’au bas de l’échelle les employés travaillent au salaire minimum.
« Si les entreprises se montrent chiches d'augmentations de salaires, nombre de grands patrons ont vu, eux, leur fiche paie grimper en flèche l'an dernier [2014]. Le record revient, pour le moment, à Jean-François Dubos, le patron de Vivendi, qui a vu bondir ses émoluments de 82 %, à 4 millions d'euros. Ceux de Thierry Breton, à la tête d'Atos, se sont envolés de 74,5 %, à 4,9 millions d'euros […]Le P-DG le mieux payé, parmi les 98 que nous avons recensé jusqu'à présent, est Christopher Viehbacher, à la tête du groupe pharmaceutique Sanofi, avec 8,6 millions d'euros (+15,6 % sur un an), dont plus de la moitié en actions et stock-options. L'équivalent de… 500 années de Smic! Il devance de peu Jean-Paul Agon, le P-DG de L'Oréal et ses 8,5 millions d'euros (+8,9 %). Bernard Arnault, le boss du géant du luxe LVMH, a récolté de son côté un peu plus de 8 millions et complète le podium (-16,1 %) (2). »
Quelle raison avance-t-on pour consentir de tels salaires à des PDG? Aucune! Leur seul mérite, aux yeux des actionnaires, est d’avoir haussé, année après année, le pourcentage de bénéfices de leurs institutions ou entreprises respectives, la plupart du temps en sabrant aveuglément les dépenses — réductions d’effectifs, fermetures d’installations, délocalisation de la production dans des pays où le coût de la main-d’œuvre est bas. N’importe quel comptable sait qu’en réduisant les dépenses on augmente nécessairement les profits ; cependant, les comptables sont généralement suffisamment avisés pour savoir qu’on ne peut pas inconsidérément réduire les dépenses sans que cela ait un impact négatif important sur l’organisation à moyen et long terme.
Nombre de PDG n’ont de toute évidence pas la même sagacité. La poursuite obsessive d’une profitabilité toujours accrue est une dérive universelle inhérente au capitalisme financier. Cette poursuite effrénée non pas d’un profit accru grâce à une augmentation des ventes, mais d’un accroissement, année après année, du pourcentage de profit n’est pas viable; elle mène nos sociétés droit dans le mur. C’est un phénomène que nous avons désigné sous le nom de financiarisation, c’est-à-dire la soumission de la gestion d’une entreprise aux diktats des investisseurs; celle-ci entraîne des effets néfastes non seulement pour l’entreprise, mais pour tout le système de production/consommation
« Si les entreprises se montrent chiches d'augmentations de salaires, nombre de grands patrons ont vu, eux, leur fiche paie grimper en flèche l'an dernier [2014]. Le record revient, pour le moment, à Jean-François Dubos, le patron de Vivendi, qui a vu bondir ses émoluments de 82 %, à 4 millions d'euros. Ceux de Thierry Breton, à la tête d'Atos, se sont envolés de 74,5 %, à 4,9 millions d'euros […]Le P-DG le mieux payé, parmi les 98 que nous avons recensé jusqu'à présent, est Christopher Viehbacher, à la tête du groupe pharmaceutique Sanofi, avec 8,6 millions d'euros (+15,6 % sur un an), dont plus de la moitié en actions et stock-options. L'équivalent de… 500 années de Smic! Il devance de peu Jean-Paul Agon, le P-DG de L'Oréal et ses 8,5 millions d'euros (+8,9 %). Bernard Arnault, le boss du géant du luxe LVMH, a récolté de son côté un peu plus de 8 millions et complète le podium (-16,1 %) (2). »
Quelle raison avance-t-on pour consentir de tels salaires à des PDG? Aucune! Leur seul mérite, aux yeux des actionnaires, est d’avoir haussé, année après année, le pourcentage de bénéfices de leurs institutions ou entreprises respectives, la plupart du temps en sabrant aveuglément les dépenses — réductions d’effectifs, fermetures d’installations, délocalisation de la production dans des pays où le coût de la main-d’œuvre est bas. N’importe quel comptable sait qu’en réduisant les dépenses on augmente nécessairement les profits ; cependant, les comptables sont généralement suffisamment avisés pour savoir qu’on ne peut pas inconsidérément réduire les dépenses sans que cela ait un impact négatif important sur l’organisation à moyen et long terme.
Nombre de PDG n’ont de toute évidence pas la même sagacité. La poursuite obsessive d’une profitabilité toujours accrue est une dérive universelle inhérente au capitalisme financier. Cette poursuite effrénée non pas d’un profit accru grâce à une augmentation des ventes, mais d’un accroissement, année après année, du pourcentage de profit n’est pas viable; elle mène nos sociétés droit dans le mur. C’est un phénomène que nous avons désigné sous le nom de financiarisation, c’est-à-dire la soumission de la gestion d’une entreprise aux diktats des investisseurs; celle-ci entraîne des effets néfastes non seulement pour l’entreprise, mais pour tout le système de production/consommation
Ainsi, la stratégie consistant à faire des mises à pied pour augmenter le profit à court terme privera à long terme une société de ressources qualifiées; malheureusement, les investisseurs se soucient peu de cette conséquence, car ils auront alors revendu leurs actions après avoir réalisé d’importants gains financiers, satisfaisant ainsi leur cupidité. Ils oublient pourtant que ces employés mis à pied sont également clients, de l’entreprise elle-même ou d’autres sociétés — ce sont des consommateurs. Certains pourront dire que les états démocratiques pourraient légiférer pour réduire les écarts salariaux; est-ce vraiment possible? Évitons de penser qu’on peut demander à l’État un égalitarisme simpliste à la Robin des bois, qui consisterait à prendre aux riches pour donner aux pauvres. Cela ne marche ni en théorie ni en pratique.
Cela ne veut pas dire que l’État ne doit pas intervenir pour assurer une redistribution de la richesse laquelle, sans pouvoir être parfaitement égalitaire, vise à assurer à tout le moins le minimum vital à tous ces citoyens. Cependant, à l’égard de la rémunération démesurée dont bénéficient certains privilégiés, le choix d’actions, pour l’État, se résume principalement à deux mesures : un contrôle de la rémunération ou une taxation accrue. Les tentatives qu’on a faites dans le premier sens se sont révélées inefficaces : on a vite trouvé moyen de les contourner.
Sur le plan fiscal, il est certain que les salaires faramineux de certains dirigeants sont insuffisamment taxés; un État, la France par exemple, pourrait-elle décider d’imposer plus lourdement ces très hauts salariés. Cela dit, pour qu’une mesure fiscale soit efficace, c’est-à-dire qu’elle fasse entrer des revenus additionnels dans les coffres, elle doit tenir compte d’une dure réalité: ces hauts salariés sont en forte demande et habituellement très mobiles. Dans le contexte de la mondialisation, les États doivent donc agir de concert en matière de fiscalité : « Un système fiscal cohérent, c’est d’abord un système en phase avec les pratiques dans les autres pays, car le travail est délocalisable, et que les conseillers en évasion fiscale ne coûte pas si cher que cela (3). »
Or, en matière de fiscalité, la recherche d’un consensus entre les États est pratiquement impossible; même en supposant qu’un grand regroupement d’états arrive à adopter une politique commune; de petits états vise fait de maintenir des politiques fiscales favorables aux hauts salariés pour attirer les sièges sociaux sur leurs territoires. Les États en sont donc réduits à adopter des solutions de compromis, nécessairement imparfaites.
Dans la prochaine tribune, nous aborderons la question de la délocalisation de la production, une stratégie qui a entraîné la destruction d’industries autrefois florissantes, tout particulièrement dans le secteur de l’habillement et de la mode.
(1) R. Rochefort, La société des consommateurs, Paris, Odile Jacob, 1995, p. 12.
(2) Le palmarès 2014 des salaires des patrons, Le Figaro, 2014 : http://www.capital.fr/carriere-management/special-salaires/2014/le-palmares-2014-des-salaires-des-patrons-922673#2VM53TPE0zFBRWgi.99
(3) O. Fassal, Tout savoir sur la finance. L’argent le pouvoir, la spéculation, le partage, Montréal, Liber, 2013, p. 48.
Cela ne veut pas dire que l’État ne doit pas intervenir pour assurer une redistribution de la richesse laquelle, sans pouvoir être parfaitement égalitaire, vise à assurer à tout le moins le minimum vital à tous ces citoyens. Cependant, à l’égard de la rémunération démesurée dont bénéficient certains privilégiés, le choix d’actions, pour l’État, se résume principalement à deux mesures : un contrôle de la rémunération ou une taxation accrue. Les tentatives qu’on a faites dans le premier sens se sont révélées inefficaces : on a vite trouvé moyen de les contourner.
Sur le plan fiscal, il est certain que les salaires faramineux de certains dirigeants sont insuffisamment taxés; un État, la France par exemple, pourrait-elle décider d’imposer plus lourdement ces très hauts salariés. Cela dit, pour qu’une mesure fiscale soit efficace, c’est-à-dire qu’elle fasse entrer des revenus additionnels dans les coffres, elle doit tenir compte d’une dure réalité: ces hauts salariés sont en forte demande et habituellement très mobiles. Dans le contexte de la mondialisation, les États doivent donc agir de concert en matière de fiscalité : « Un système fiscal cohérent, c’est d’abord un système en phase avec les pratiques dans les autres pays, car le travail est délocalisable, et que les conseillers en évasion fiscale ne coûte pas si cher que cela (3). »
Or, en matière de fiscalité, la recherche d’un consensus entre les États est pratiquement impossible; même en supposant qu’un grand regroupement d’états arrive à adopter une politique commune; de petits états vise fait de maintenir des politiques fiscales favorables aux hauts salariés pour attirer les sièges sociaux sur leurs territoires. Les États en sont donc réduits à adopter des solutions de compromis, nécessairement imparfaites.
Dans la prochaine tribune, nous aborderons la question de la délocalisation de la production, une stratégie qui a entraîné la destruction d’industries autrefois florissantes, tout particulièrement dans le secteur de l’habillement et de la mode.
(1) R. Rochefort, La société des consommateurs, Paris, Odile Jacob, 1995, p. 12.
(2) Le palmarès 2014 des salaires des patrons, Le Figaro, 2014 : http://www.capital.fr/carriere-management/special-salaires/2014/le-palmares-2014-des-salaires-des-patrons-922673#2VM53TPE0zFBRWgi.99
(3) O. Fassal, Tout savoir sur la finance. L’argent le pouvoir, la spéculation, le partage, Montréal, Liber, 2013, p. 48.
Benoit Duguay est professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, où il oeuvre depuis 2003, et chercheur à la Chaire de relations publiques et communication marketing. Il a précédemment fait carrière en ventes et marketing, principalement dans l’industrie informatique, au sein de sociétés multinationales et de petites et moyennes entreprises.
Il est notamment l'auteur de Consommation et nouvelles technologies (2009), Consommation et luxe (2007) et Consommation et image de soi (2005). Son dernier ouvrage Consommer, consumer. Dérives de la consommation (2014), paru aux Editions Liber, fait l'historique de la société de consommation et étudie en détail ce que l'auteur dépeint comme la "société de consumation". Au delà de cette analyse, Benoit Duguay nous invite à une réflexion autour de notre société de l'excès.
Il est notamment l'auteur de Consommation et nouvelles technologies (2009), Consommation et luxe (2007) et Consommation et image de soi (2005). Son dernier ouvrage Consommer, consumer. Dérives de la consommation (2014), paru aux Editions Liber, fait l'historique de la société de consommation et étudie en détail ce que l'auteur dépeint comme la "société de consumation". Au delà de cette analyse, Benoit Duguay nous invite à une réflexion autour de notre société de l'excès.